Les médicaments génériques représentent plus de 90 % des prescriptions aux États-Unis aujourd’hui. Ce n’est pas le fruit du hasard. C’est le résultat direct d’une loi conçue pour briser les monopoles : le Hatch-Waxman Act, adoptée en 1984. Mais derrière cette réussite, se cache une bataille juridique constante. Des laboratoires pharmaceutiques utilisent des stratagèmes pour repousser l’arrivée des génériques - et les lois antitrust sont là pour les arrêter.
Comment les génériques ont changé la donne
Avant 1984, un médicament breveté pouvait rester sur le marché pendant des années sans concurrence. Même après l’expiration du brevet, les fabricants de génériques avaient du mal à entrer : procédures lourdes, coûts élevés, incertitudes juridiques. Le Hatch-Waxman Act a tout changé. Il a créé un chemin simplifié pour les génériques : l’ANDA (Abbreviated New Drug Application). Plus besoin de refaire tous les essais cliniques. Il suffit de prouver que le générique est équivalent au médicament d’origine. Mais la loi a aussi donné un pouvoir exceptionnel au premier générique à déposer une demande avec une certification de type Paragraph IV : 180 jours d’exclusivité sur le marché. C’était une incitation pour les entreprises les plus agressives. Résultat ? En 2012, les génériques ont fait économiser 217 milliards de dollars aux Américains. En 10 ans, entre 2005 et 2014, ce sont 1,68 trillion de dollars qui ont été économisés. C’est l’équivalent du budget annuel de la France.Les pièges des laboratoires : pay-for-delay et autres stratagèmes
Le système fonctionne… sauf quand les laboratoires d’origine paient les génériques pour qu’ils ne viennent pas. C’est ce qu’on appelle les accords de pay-for-delay. Un laboratoire breveté verse des millions à un fabricant de génériques pour qu’il reporte sa sortie sur le marché. En échange, le générique renonce à contester le brevet. C’est un marché noir de la concurrence. Le brevet n’est pas invalidé - il est simplement acheté. La FTC (Federal Trade Commission) a dénombré 18 de ces accords entre 2000 et 2023. En 2013, la Cour suprême des États-Unis a jugé ces pratiques illégales dans l’affaire FTC v. Actavis. Mais les entreprises n’ont pas arrêté. En 2023, Gilead Sciences a payé 246,8 millions de dollars pour régler une affaire similaire sur un médicament contre le VIH. Autre stratagème : le product hopping. Une entreprise modifie légèrement son médicament - une nouvelle forme, un nouveau dosage - juste avant l’expiration du brevet. Elle met alors en avant cette version comme « améliorée », et prescrit aux médecins de ne plus prescrire l’ancien. Résultat ? Les génériques ne peuvent pas entrer sur le marché de l’ancien produit. C’est ce qui s’est passé avec AstraZeneca et ses médicaments Prilosec et Nexium. Les génériques de Prilosec étaient prêts, mais la demande a été déviée vers Nexium. Les consommateurs ont payé plus cher, pendant des années.Les abus du système réglementaire
Le système de la FDA repose sur une liste publique : l’Orange Book. Elle recense tous les brevets liés à un médicament. Les génériques doivent les contester un par un. Mais certains laboratoires abusent de cette liste. Ils y inscrivent des brevets qui n’ont rien à voir avec la composition du médicament. Des brevets sur l’emballage, sur un procédé de fabrication, sur une méthode d’administration. Cela bloque les génériques. En 2003, la FTC a poursuivi Bristol-Myers Squibb pour avoir listé des brevets inutiles pour freiner la concurrence. Autre technique : les citizen petitions. Un laboratoire dépose une demande formelle à la FDA pour alerter sur un danger supposé du générique. Pas de preuve scientifique ? Peu importe. La FDA doit répondre. Et pendant ce temps, le générique attend. En 2023, la FTC a poursuivi Teva Pharmaceuticals pour avoir déposé de telles pétitions pour retarder l’entrée d’un générique contre la sclérose en plaques.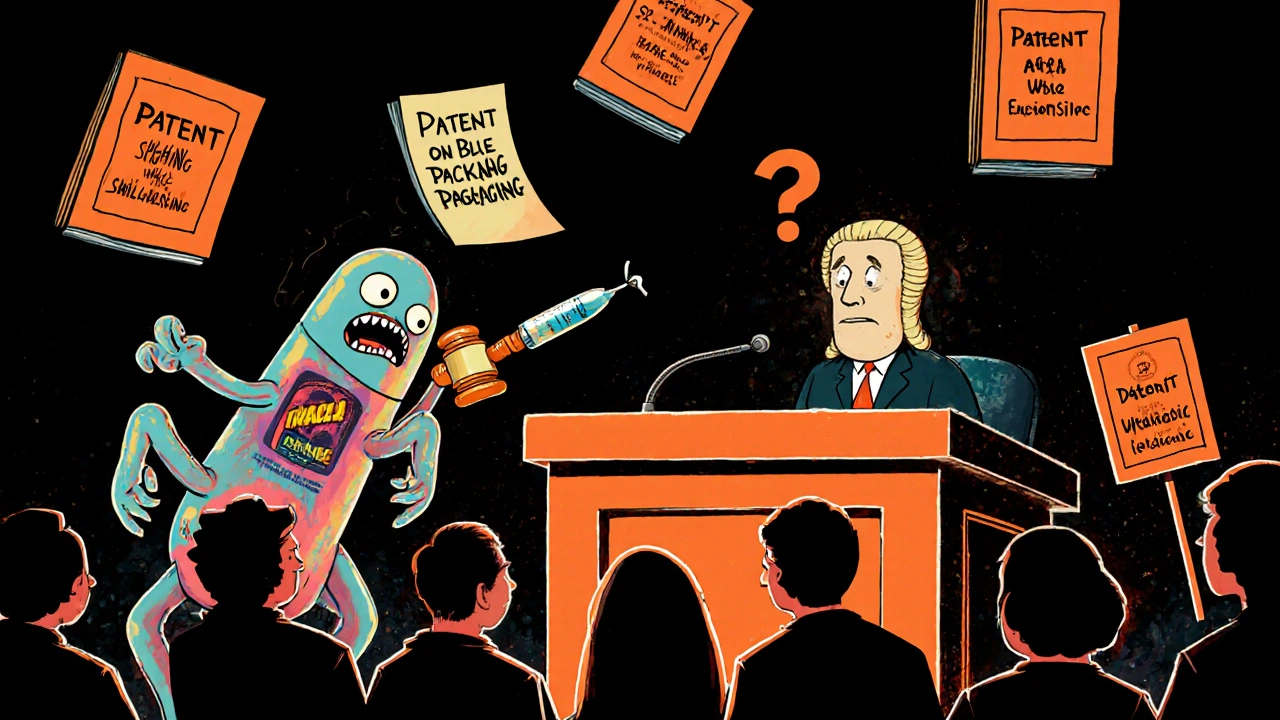
La lutte en Europe et en Chine
En Europe, la Commission européenne a ouvert 27 affaires antitrust dans le secteur pharmaceutique entre 2018 et 2022. 60 % concernaient le retard d’entrée des génériques. Ici, les abus sont souvent plus subtils : retrait stratégique des autorisations de mise sur le marché dans certains pays, ou déclarations mensongères auprès des offices de brevets pour prolonger la protection. Les autorités européennes s’inquiètent aussi de la dévalorisation des génériques. Certains laboratoires diffusent des messages faux sur les génériques : « Moins efficaces », « Plus de risques », « Non testés ». Ces campagnes de désinformation réduisent la confiance des médecins et des patients. Une étude de la Cour de justice européenne a reconnu cela comme une pratique anticoncurrentielle. En Chine, la réponse est plus directe. En janvier 2025, le pays a publié ses Guidelines antitrust pour le secteur pharmaceutique. Il identifie cinq pratiques interdites : fixation des prix, restriction de la production, partage de marché, boycottage collectif, et blocage de l’innovation. En moins de trois mois, six entreprises ont été sanctionnées. Cinq d’entre elles avaient fixé les prix par des accords écrits, des réunions secrètes, ou même des algorithmes sur des applications de messagerie.Qui paie le prix fort ?
Derrière ces affaires juridiques, il y a des gens. Des patients qui ne prennent pas leurs médicaments parce qu’ils coûtent trop cher. Une enquête de la Kaiser Family Foundation en 2022 a montré que 29 % des Américains n’ont pas pris leur traitement comme prescrit à cause du prix. C’est une crise de santé publique. Les génériques réduisent les prix de 30 à 90 %. Mais si l’entrée est bloquée, les prix restent élevés. Et les laboratoires d’origine continuent à gagner des milliards. En 2023, les six plus grandes entreprises pharmaceutiques ont réalisé un bénéfice net combiné de plus de 100 milliards de dollars. Pendant ce temps, des millions de personnes choisissent entre manger et prendre leur traitement.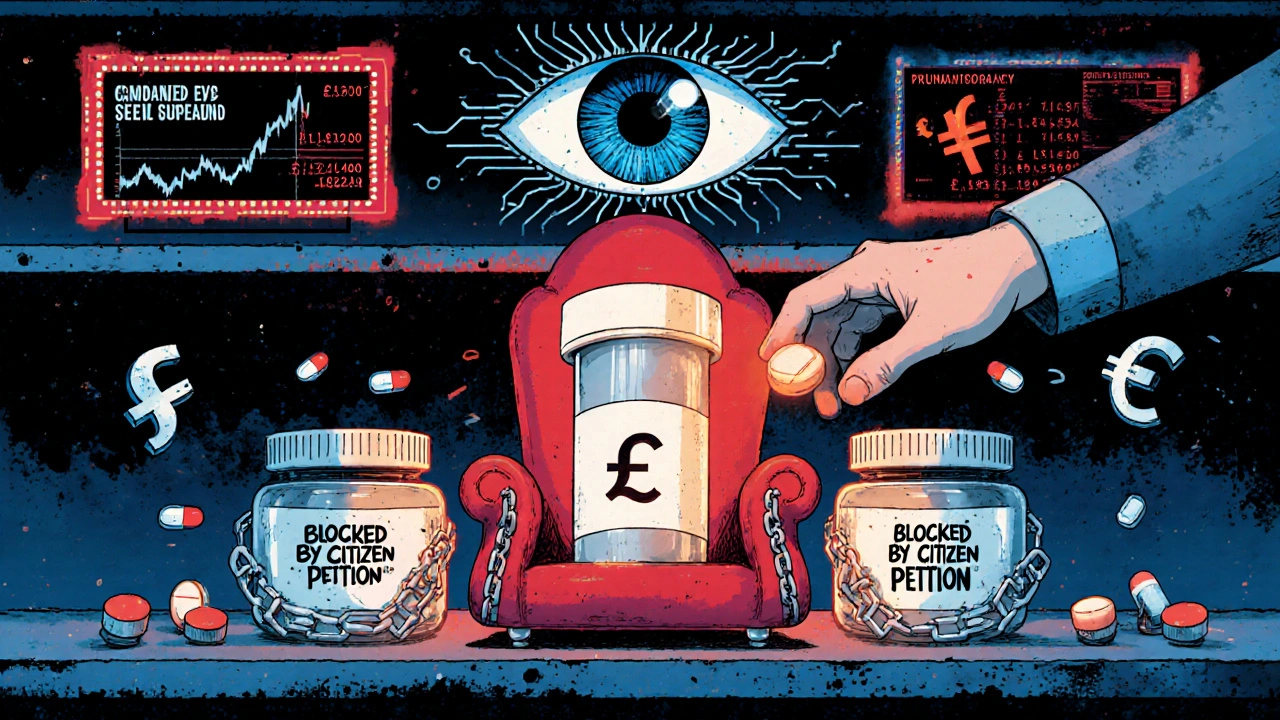
Le futur : l’IA et la surveillance des prix
La Chine utilise maintenant l’intelligence artificielle pour détecter les collusions en temps réel. Elle surveille les variations de prix sur les plateformes en ligne, les communications entre entreprises, les algorithmes de fixation des prix. C’est une avancée majeure. Aux États-Unis, la FTC a organisé en 2022 un atelier sur l’entrée des génériques après l’expiration des brevets. Les experts ont souligné que les pratiques évoluent. Les accords de pay-for-delay ne sont plus aussi évidents. Ils sont cachés dans des clauses complexes, des paiements indirects, des partenariats de distribution. La bataille ne fait que commencer. Les lois antitrust ne sont pas des armes statiques. Elles doivent s’adapter à la créativité des entreprises qui veulent protéger leurs profits au détriment de la concurrence.Que faire quand un générique tarde à arriver ?
Si vous êtes médecin, patient, ou simplement un citoyen concerné, voici ce que vous pouvez faire :- Questionnez les prescripteurs : pourquoi ce médicament est-il encore cher ? Un générique existe-t-il ?
- Signalez les publicités mensongères sur les génériques à l’agence de santé locale.
- Appuyez les organisations qui luttent pour l’accès aux médicaments.
- En Europe, déposez une plainte auprès de votre autorité nationale de concurrence si vous soupçonnez un retard abusif.
- En Chine ou aux États-Unis, les plaintes anonymes peuvent être transmises à la FTC ou à la SAMR (Autorité chinoise de la concurrence).
La concurrence dans les génériques n’est pas un luxe. C’est une question de vie ou de mort.
Qu’est-ce que le Hatch-Waxman Act et pourquoi est-il important pour les génériques ?
Le Hatch-Waxman Act, adopté en 1984 aux États-Unis, a créé un cadre juridique pour accélérer l’entrée des médicaments génériques sur le marché. Il permet aux fabricants de génériques de déposer une demande simplifiée (ANDA) sans refaire tous les essais cliniques, à condition de prouver l’équivalence avec le médicament d’origine. En échange, il accorde au premier générique à contester un brevet une exclusivité de 180 jours. Ce système a permis aux génériques d’atteindre plus de 90 % des prescriptions aux États-Unis, générant des milliards d’économies pour les patients.
Qu’est-ce qu’un accord de pay-for-delay ?
Un accord de pay-for-delay est un contrat secret entre un laboratoire fabricant d’un médicament breveté et un producteur de générique. Le laboratoire paie le générique pour qu’il reporte son entrée sur le marché. Cela permet au breveté de prolonger son monopole sans avoir à prouver que son brevet est valide. Ces accords sont illégaux aux États-Unis depuis la décision de la Cour suprême dans FTC v. Actavis (2013), mais ils persistent sous des formes plus cachées.
Comment les laboratoires empêchent-ils l’entrée des génériques sans violer les brevets ?
Ils utilisent plusieurs stratagèmes : ils listent des brevets inutiles dans l’Orange Book pour bloquer les génériques, déposent des pétitions citoyennes pour retarder l’approbation de la FDA, modifient légèrement leur médicament (product hopping) pour détourner les prescriptions, ou diffusent des informations fausses sur la qualité des génériques. Ces pratiques ne violent pas directement les brevets, mais elles entravent la concurrence de manière illégale.
Les génériques sont-ils aussi sûrs que les médicaments d’origine ?
Oui. Pour être approuvé, un générique doit prouver qu’il contient la même substance active, dans la même dose, et qu’il est absorbé de la même manière que le médicament d’origine. La FDA et l’EMA (Agence européenne des médicaments) exigent des tests rigoureux. Les études montrent que les génériques sont tout aussi efficaces et sûrs. Les campagnes de dénigrement sont souvent financées par les laboratoires d’origine pour protéger leurs marges.
Pourquoi les prix des médicaments restent-ils élevés même après l’expiration du brevet ?
Parce que l’entrée des génériques est souvent bloquée par des pratiques anticoncurrentielles : pay-for-delay, product hopping, abus du système de brevets, ou désinformation. Même si le brevet est expiré, si aucun générique n’arrive sur le marché, le prix reste élevé. Dans certains cas, plusieurs années s’écoulent avant que la concurrence ne se développe réellement.


Ecrit par Gaëlle Veyrat
Voir tous les articles par: Gaëlle Veyrat